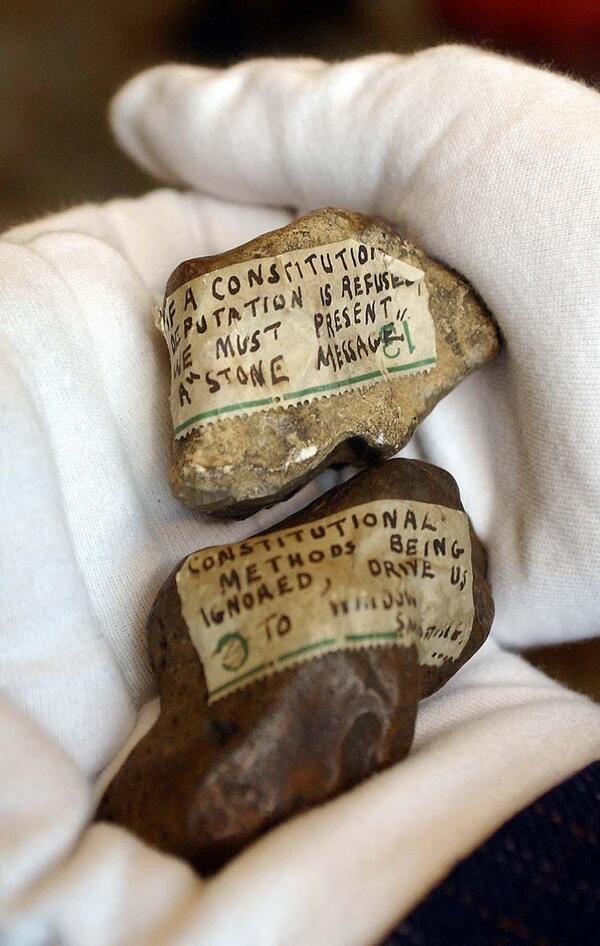Ecrivant en plein romantisme et tout en reprenant des thèmes chers à l’école, la poétesse s’en dégage. Entre autres dans son rapport avec la nature et ce qui s’y inscrit. Les descriptions rapprochent l’auteure de l’époque contemporaine d’une certaine « école du regard » voire d’une forme de pré– postmodernisme. Nul pathos ou sentimentalisme. La nature parle d’elle-même ; à l’auteure (et son lecteur) de s’y découvrir « Tel l’antédiluvien reptile saisi dans ce qui est devenu pierre ».
L’angoisse est là mais l’espérance tout autant comme lorsqu’elle évoque la nuit énigmatique où un docteur part soigner un brigand de la lande ou un enfant seul dans la tourbière voire la description d’une fosse de marne. Les moments inquiétants se métamorphosent entre rêve et réalité là où Annette von Droste-Hülshoff maîtrise autant l’ellipse que des termes scientifiques et le goût des assonances.
L’opulence de la nature passe par la traque d’un langage majeur qui apaise la puissance nocturne caressée par le romantisme allemand. Dans l’intime du silence, l’ivresse linguistique reste lucide. Le ruissellement du paysage n’est jamais exacerbé par une conscience trop tragique de l’existence. L’art gagne en sérénité là où, derrière l’ombre, percent la paix et la lumière".
jean-paul gavard-perret
Annette von Droste-Hülshoff, Tableaux de la lande, trad. Patrick Suter & Bernard Böschenstein (éd. bilingue) LaDogana, Genève, 2017.